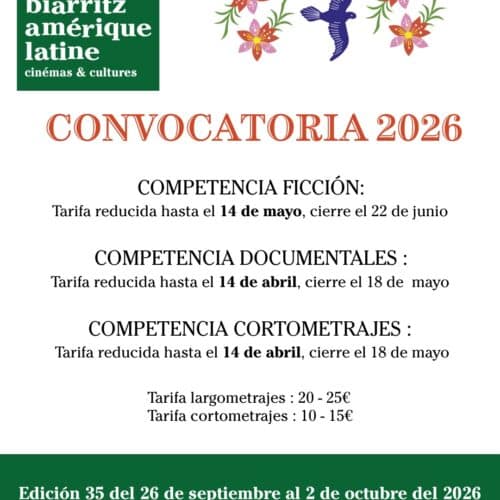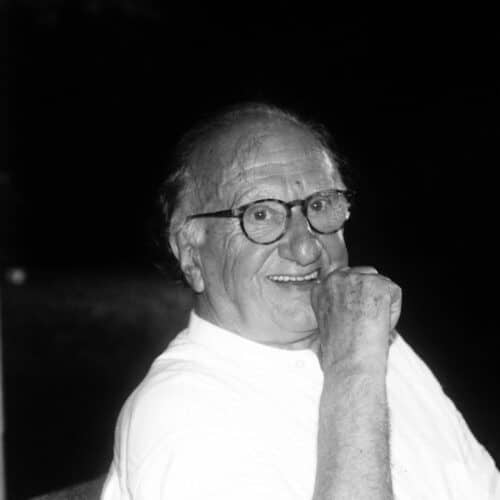Vous avez aimé La Quotidienne, notre journal du festival ? Retrouvez toutes les grandes interviews en exclusivité. La réalisatrice brésilienne Anna Muylaert revient sur son dernier long métrage A Melhor Mãe do Mundo, et passe au crible schémas familiaux, violences faites aux femmes et inégalités sociales dans son pays.
Vos films abordent souvent le thème de la parentalité, dans des modèles familiaux assez particuliers. Cela vous tient à coeur ? Reflète-t-il une partie de votre enfance ?
A. M. : J’ai grandi dans une famille très autoritaire, où tout était géré par le père. Ma mère, elle, était éffacée, humiliée. Ma famille ne m’a pas laissé beaucoup de liberté, elle était très contrôlante. J’ai beaucoup souffert, je n’étais pas libre de parler librement. Alors forcément, aborder la violence dans la famille est quelque chose qui est très présent dans ma filmographie. Dans A Melhor Mãe do Mundo, je crois que c’était plus pour représenter un désir d’une figure de mère forte, plus forte que l’homme et sa violence. La maternité et la place de la mère sont des questions sociales extrêmement importantes au Brésil, par exemple dans Que Horas Ela Volta ? (Une seconde mère) où la mère est obligée d’abandonner son enfant. Il existe différent types de mère en fait. Dans mon film, j’ai réalisé un rêve personnel que je n’ai malheureusement pas vu se concrétiser dans ma vie : celui de voir une femme, ma mère, s’émanciper de son mari.
Dans les films latino-américains, il n’est pas rare de voir des portraits de femmes s’émanciper de leur condition. Dans A Melhor Mae do Mundo, on voit, en plus, le regard dur que porte les gens envers la femme pour toujours soutenir l’homme. Qu’est ce que vous avez voulu dénoncer avec ce nouveau personnage qu’est la société ?
A. M. : La société latine est très machiste, le Brésil n’est pas épargné. Les hommes n’ont pas honte d’être violents. Une femme qui tente d’être libre, que ce soit professionnellement ou personnellement, se prend les jugements et la violence des gens qui l’entourent et finit toujours par être seule.
Dans votre film, est-ce la mère qui sauve ses enfants ou est-ce que ce sont les enfants qui sauvent la mère ? Se sauvent-ils tous les trois grâce à la force du collectif et de la famille ?
A. M. : Je crois que la mère comme éducatrice fondamentale de l’humanité a la capacité de générer des choses heureuses ou des choses malheureuses, je voulais pouvoir parler de ce pouvoir. Si elle reste avec un homme toxique, cela aura forcément un impact sur ses enfants. S’il n’abuse pas d’elle, il abusera probablement d’eux et s’il n’abuse pas d’eux, cela leur fera quand même du mal. D’une certaine manière, elle les condamne en restant avec lui. Ici au Brésil, le mariage est parfois plus important pour certaines femmes que le futur de leurs enfants et le leur. Dans ce film, le point de bascule arrive quand Gal comprend que son mari va aussi faire du mal à ses enfants.
Vos films dressent souvent le portrait d’une société brisée. C’est impossible de parler du Brésil sans parler des inégalités sociales ?
A. M. : Oui je crois que le Brésil se caractérise par plein de qualités naturelles et culturelles, de grandes richesses comme la musique, le foot, la culture africaine aussi. Mais la structure sociale est encore très coloniale, avec beaucoup d’héritage de la période portugaise. La question sociale est très liée à la question des origines. Ça s’améliore peu à peu, mais il manque encore beaucoup quant à l’égalité ethnique, de genre ou sociale.
Question bonus : Quelle image avez-vous de Biarritz ?
A.M. : Je ne suis encore jamais venue mais j’en ai beaucoup entendu parler, et ce dès la faculté ! Beaucoup de mes amis sont venus. J’ai hâte d’en faire l’expérience pour pouvoir répondre à cette question !
Propos recueillis par Joana Diaz et Julia Castaing

La réalisatrice brésilienne Anna Muylaert au FBAL 2025. Patrick Tohier Photomobile